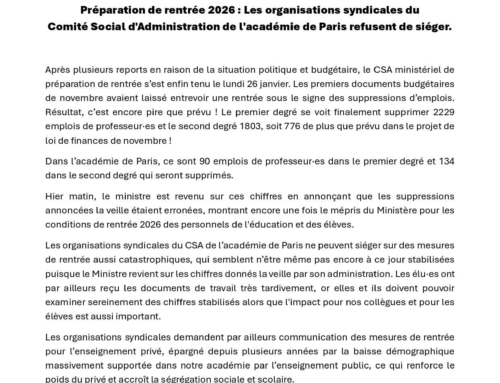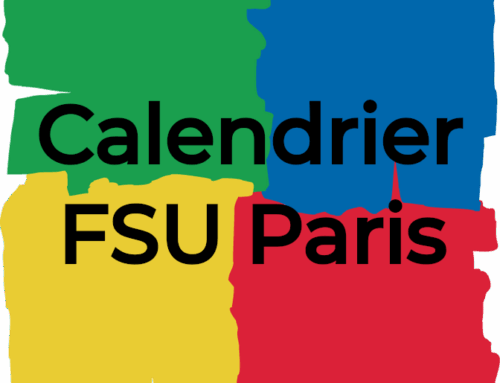On connaît cette formule : le service public, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. C’est à la fois vrai et réducteur. C’est vrai sur le plan économique et social. Une étude de l’Insee avait même montré en 2008 que certains des plus importants services publics étaient deux fois plus efficaces que les prestations monétaires (la redistribution) pour réduire les inégalités. Mais c’est réducteur en ce sens que les services publics, lorsqu’ils fonctionnent conformément à leurs missions, sont des biens communs, des patrimoines pour tous.
On connaît cette formule : le service public, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. C’est à la fois vrai et réducteur. C’est vrai sur le plan économique et social. Une étude de l’Insee avait même montré en 2008 que certains des plus importants services publics étaient deux fois plus efficaces que les prestations monétaires (la redistribution) pour réduire les inégalités. Mais c’est réducteur en ce sens que les services publics, lorsqu’ils fonctionnent conformément à leurs missions, sont des biens communs, des patrimoines pour tous.
Jean Gadrey Professeur honoraire d’économie à l’Université Lille 1 partie prenante de tous les combats POUR le service public, publie dans Alternatives économiques un excellent plaidoyer pour ce bien commun.
Ce qui les caractérise c’est leur universalité, associée à des droits reconnus, donc leur accessibilité à un prix abordable par tous, allant jusqu’à la gratuité pour certains d’entre eux. C’est leur contribution à la cohésion sociale et territoriale, à l’égalisation des conditions d’existence et à la soutenabilité de notre trajectoire collective. La doctrine historique des services publics repose sur la continuité (dans le temps), la « mutabilité » (adaptation à l’évolution des besoins collectifs), et l’égalité, un mot absent des « réformes » projetées.
En amont des débats sur la dette de la SNCF, le statut des agents, l’introduction de la concurrence puis des privatisations, il faut se poser une question bien plus importante : quelle est l’utilité sociale (y compris écologique) d’un service public ? Comment peut-on « en même temps » commander, pour les entreprises privées, un rapport (au demeurant décevant, voir cette tribune de Michel Capron) sur leur contribution à l’intérêt collectif, et négliger, comme le fait le gouvernement, la contribution des services publics à l’intérêt général ? Une fois de plus, les critères comptables et la religion de l’austérité publique l’emportent sur la raison d’être des services publics depuis qu’ils existent.
Quelle mission d’intérêt général ?
Il faut, avant tout autre argument, défendre les missions d’intérêt général des services publics (dont les services publics dits de réseau comme la SNCF) au nom d’une vision solidaire de la citoyenneté moderne. Ne pas recevoir le courrier ou ne pas pouvoir en envoyer dans des conditions acceptables, ne pas recevoir l’eau potable, ne pas pouvoir se raccorder à un réseau téléphonique, ne pas recevoir l’électricité, ne pas pouvoir se chauffer, ne pas avoir de « transports en commun » locaux ou nationaux accessibles à un prix abordable, sont des indices d’une citoyenneté de seconde zone, dans une société divisée entre ceux qui sont connectés aux réseaux de la vie quotidienne et ceux qui ne le sont pas. Tel est l’argument principal des défenseurs des missions de service public, lesquelles ne peuvent pas être « rentables » au sens financier, même lorsque leur utilité écologique et sociale est considérable.
La mise en concurrence (c’est ce qui définit la « dérégulation ») peut-elle préserver de tels droits pour tous ? La réponse est négative pour de multiples raisons. D’abord, comme l’a montré Albert Hirschman, dans les cas où un monopole « historique » existe, l’introduction de la concurrence conduit à la dégradation des missions d’intérêt général et à l’instauration de « services à deux vitesses ». Pendant que les usagers aisés se tournent vers des services privés lucratifs et plus coûteux, ce qui reste de service public se dégrade et tend à passer du statut de service vraiment universel à celui de service minimal des pauvres.
Selon les libéraux, on pourrait conjurer ce risque en confiant à de nouvelles « autorités de régulation » le soin de veiller à ce que le service universel reste fourni. Parmi d’autres solutions, ils proposent par exemple d’imposer à tout opérateur intervenant sur les segments rentables de verser une contribution à un fonds reversé à « l’opérateur historique » qui continuera à assumer la charge des obligations collectives non rentables.
Manipulations
Mais ces théories des économistes libéraux échouent en pratique. En effet, pour pouvoir concilier la concurrence privée et les missions d’intérêt général sur la base de contrats, il faut supposer que ces missions peuvent être définies selon une vision partagée de l’intérêt général, il faut des informations fiables sur les coûts du service universel, etc., autant de choses qui se prêtent à des manipulations et à la rétention d’information. Ces manipulations peuvent aller bien plus loin que dans le contrôle des entreprises publiques, parce que des intérêts privés gigantesques sont en jeu, et parce que la concurrence s’accompagne du secret dans divers domaines. Des exemples spectaculaires l’ont prouvé, comme l’énorme scandale ENRON aux Etats-Unis.
Enfin, toute « dérégulation » d’un service public de réseau s’accompagne d’un démantèlement dont les effets sont le plus souvent contre-productifs. Il faut en effet « produire de la concurrence » ex nihilo et pour cela découper le monopole historique en de multiples « centres de profits » ou filiales se vendant des prestations en faisant fonctionner la concurrence interne et externe, au détriment de la coopération et de la complémentarité internes.
Contre-exemple britannique
Ainsi, en Grande-Bretagne, la privatisation de British Railways, à partir de 1994, a maintenu un droit de monopole pour le réseau ferré (Railtrack), en le privatisant lui-même. On a par ailleurs créé une centaine (!) d’entreprises privées issues de l’entreprise publique démantelée, dont 25 compagnies franchisées pour le trafic voyageur, ou des compagnies louant des trains, louant ou sous-louant des gares ou des parties de gares, etc. Ces entreprises étaient en concurrence, ce qui, selon les promoteurs de la dérégulation, devait conduire à une baisse des prix et à une amélioration de la qualité. Pas de chance pour ces idéologues : les trains britanniques sont devenus les plus chers d’Europe (cinq fois plus que la moyenne européenne selon le Times !), pour une qualité très médiocre, et l’immense majorité des Britanniques est favorable à la renationalisation.
Un dernier argument, non économique, est essentiel : l’accomplissement des missions d’intérêt général n’est pas qu’un problème de régulation ou de « coûts ». Il repose sur des valeurs que l’introduction de la concurrence met à mal. Les agents de La Poste, auprès desquels j’ai pu dans le passé enquêter sur le terrain, considèrent par exemple, dans leur majorité, qu’il peut être légitime de consacrer autant ou plus de temps à des « usagers » en difficulté, aux marges de l’exclusion sociale, qu’aux « clients » rentables, en contradiction avec les impératifs usuels d’une entreprise capitaliste. Dans un contexte dérégulé, ces comportements pourtant dotés d’une grande utilité sociale, devront disparaître ou devenir marginaux. C’est d’ailleurs ce qui est en train de se produire graduellement.
D’autant qu’avec la mise en concurrence, les entreprises, comme les salariés, tendent à être évaluées sur leurs performances commerciales. Il n’est pas possible de concilier ces incitations nouvelles avec une identité professionnelle qui reste souvent, trop souvent aux yeux des managers « modernistes », attachée aux valeurs de service public. Une identité qui souffre, depuis des années, et qui fait pourtant partie du meilleur du service public comme bien commun.
 PARIS
PARIS